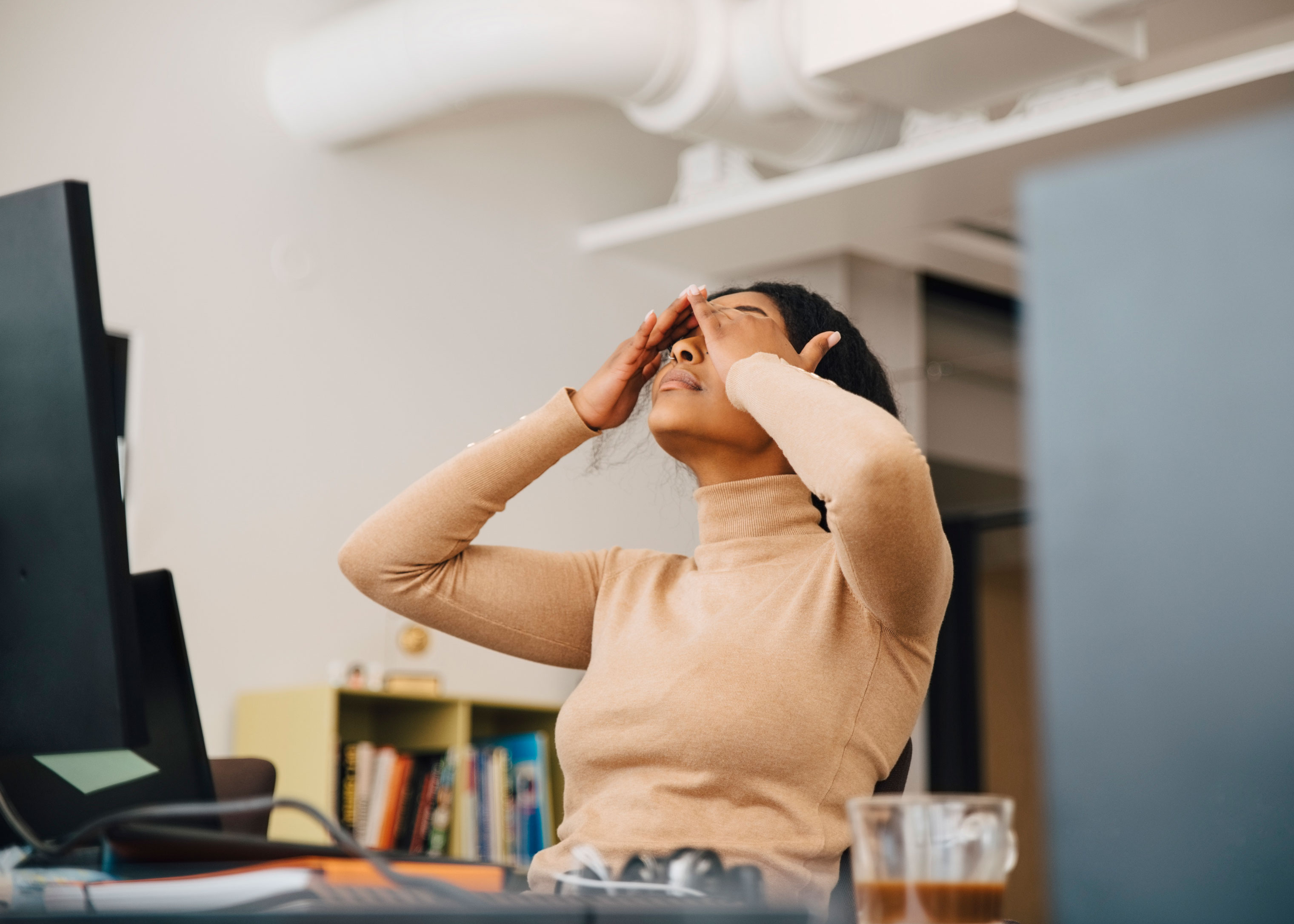Publicité
Publicité - continuer votre lecture ci-dessous
Début du contenu principal.
Si vous allez à l’épicerie régulièrement (qui n’y va pas?), vous avez certainement remarqué les étiquettes indiquant la provenance des aliments canadiens. Une petite feuille d’érable sur le coin d’une boîte, par exemple.
On ne peut le nier, il y a un engouement pour les produits d’ici afin de remplacer les aliments américains qu’on boycotte.
Mais quels sont les impacts financiers réels de ce boycottage sur l’industrie américaine? Risque-t-on de se tirer dans le pied et de nuire aux travailleurs canadiens embauchés par des marques américaines?
En 2024, les exportations des États-Unis vers le Canada représentaient 349,4 milliards de dollars. Si les Canadiens boycottent ne serait-ce que 10% de ces produits, les pertes pourraient atteindre 34,9 milliards pour les États-Unis.
Voici une exploration des impacts possibles à moyen terme et des écueils à éviter.
Du Canada dans votre assiette… et dans votre verre
Sur le plan de l’alimentation, les Québécois et autres Canadiens montrent plus d’intérêt pour les produits d’ici. C’est toutefois difficile de chiffrer l’impact financier exact de nos nouveaux choix.
Pour donner un exemple, prenons le cas où nous n’achèterions plus aucun produit importé des États-Unis. Il y a plus de 16% des exportations alimentaires américaines qui aboutissent chez nous. On parle d’environ 25 milliards de revenus potentiellement perdus.
Le cas concret le plus évident est l’alcool américain, disparu des tablettes de la SAQ depuis quelques semaines. Mais seulement 7% des vins et spiritueux vendus à la SAQ étaient américains. La valeur des produits retirés des tablettes atteint tout de même plus de 26 millions de dollars. Les États-Unis perdent donc les recettes de ces ventes, et jusqu’à nouvel ordre, tout espoir de ventes futures.

Changer vos plans de vacances
Vous aimez vous prélasser sur les plages américaines? Vos enfants rêvent de visiter Disney World? Si vous êtes comme la majorité des Québécois, ce n’est pas cette année que ça va se passer...
On compte 56% d’entre nous ayant décidé de modifier leur destination de vacances pour éviter nos voisins du Sud. Même son de cloche de la part de l’ensemble des canadiens.
La U.S. Travel Association redoute des pertes de revenus touristiques d’au moins 2,1 milliards de dollars et la perte de 14 000 emplois à cause de ce mouvement de boycottage. Et ceci est basé sur une baisse de seulement 10% du nombre de visiteurs canadiens!
S’il y a un boycottage d’au moins 50% des voyages, on parlerait alors de 10 milliards de pertes financières.
Véhicules: un boycottage plus complexe
Saviez-vous que les ventes de Tesla ont chuté de 70% dernièrement? C’est énorme! Évidemment, ce n’est pas uniquement dû aux frasques d’Elon Musk, mais aussi à la pause de subventions gouvernementales pour ces véhicules électriques.
Le même phénomène s’observe en Europe, avec une chute d’environ 50% des ventes de Tesla. Ce boycottage semble porter ses fruits, car le milliardaire devrait retourner à la tête de ses entreprises bientôt.
La Canada importe près de 85 milliards de dollars de voitures et pièces automobiles des États-Unis annuellement. L’industrie est fortement intégrée et les usines ne peuvent pas être modifiées du jour au lendemain. C’est pourquoi les tarifs de 25% sur l’automobile annoncés le 2 avril pourraient toucher autant les États-Unis que le Canada.
Ainsi, boycotter les marques de voitures américaines sera inefficace si la moitié d’un tel véhicule est construit ici.
Boycotter les marques de voitures américaines sera inefficace compte tenu que la moitié d’un tel véhicule est construit ici.

Culture: un détachement difficile
Les États-Unis sont le berceau de grandes entreprises qu’on adore, comme Netflix. En effet, 70% des Canadiens ont utilisé ce service de diffusion en continu en 2024. Sur les 300 millions d’abonnés de Netflix à travers le monde, on en compterait près de 20 millions au Canada.
Si chacun de nous s’en désabonne demain matin, le Canada privera Netflix de 160 millions de dollars en revenus, voire plus. Cette somme tient compte uniquement du forfait de base à 7,99$ par mois. L’impact reste faible, dans la mesure où les Canadiens représentent seulement 6,7% des abonnés totaux de la compagnie.
L’intégration complexe de l’économie de nos deux pays
Plusieurs experts l’ont souligné: le boycottage de certains produits américains risque d’affecter les travailleurs québécois.
Plusieurs experts l’ont souligné, le boycottage de certains produits américains risque d’affecter les travailleurs québécois. La raison est simple: plusieurs secteurs économiques sont dépendants l’un de l’autre.
Par exemple, plusieurs marques américaines ont implanté des usines au Canada, qui embauchent des travailleurs canadiens. Si leurs revenus baissent et qu’elles ne vendent presque plus de produits ici, ces compagnies pourraient fermer leurs usines locales.
C’est le cas du ketchup Heinz, fabriqué à Montréal, et des chips Lays, qui ont des usines en Alberta, en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse. Dans le domaine de l’automobile, on sait que les pièces peuvent traverser la frontière plusieurs fois avant de constituer un véhicule fini et prêt à être vendu.
C’est la même chose lorsqu’on se désabonne des géants du numérique. Par exemple, de nombreuses petites et moyennes entreprises québécoises s’en servent pour faire de la publicité et vendre leurs produits. Les priver de leurs outils de marketing risque de faire baisser leurs ventes et de nuire aux entreprises locales.

Le boycottage, est-ce vraiment efficace?
L’intégration de l’économie canadienne et américaine sème le doute: est-ce une bonne idée de boycotter? En somme, la réponse est oui.
Le consensus scientifique veut qu’un boycottage ciblé soit plus efficace qu’un boycottage tous azimuts. Ce serait donc la recette du succès.
Pour l’instant, les Canadiens ne semblent pas avoir choisi une cible précise, mais espérons que les quelques chiffres présentés ici pourront vous inspirer à frapper là où ça fait le plus mal.
Par exemple, les voyages ont un impact concret et c’est facile de changer nos habitudes. L’automobile représente une industrie plus imposante, mais c’est plus délicat, car on risque de faire mal à notre propre économie.
Vous aimerez aussi:
- Comment faire votre part pour soutenir l’économie canadienne?
- 8 marques québécoises à ajouter à votre garde-robe
- Le dollar canadien en chute libre
Consulter tous les contenus de Maude Gauthier